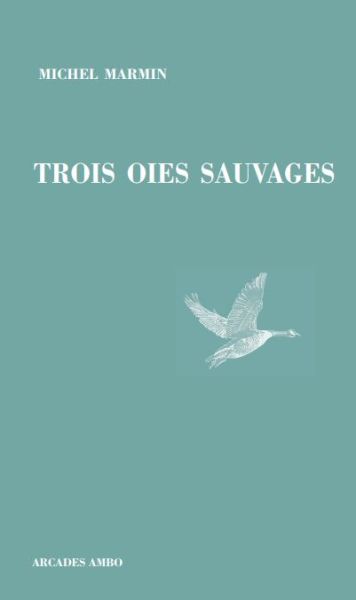Accueil/Actualités/Un magnifique portrait de Michel Marmin
Actualités
Un magnifique portrait de Michel Marmin
vendredi 4 octobre 2024
Allez donc voir un peu les poèmes de Michel Marmin !
par François Bousquet
On croit connaître Michel Marmin, mais on n’en finit pas de le découvrir. C’est comme une sorte de poupée russe à la mode de chez nous. Le critique cache un scénariste, lequel abrite un historien du septième art, qui recèle un musicologue, un encyclopédiste, un journaliste, que sais-je encore, et quand on a fini d’enlever toutes les couches, on tombe sur le noyau d’origine – l’infracassable noyau de nuit, comme disait André Breton, ou de lumière : la poésie, d’où tout part et tout aboutit. Car c’est d’abord un poète. Il nous l’avait caché jusqu’à Chemin d’ailleurs et de Damas, recueil paru à L’Âge d’Homme, en 2000. À quoi bon le faire savoir ! Un jardin secret est un jardin secret.
Michel Marmin a passé sa vie à se consacrer aux autres, si bien qu’il a fini par s’oublier quelque peu. On ne compte plus les grands noms avec lesquels il a travaillé, de Pierre Schaeffer à Léo Malet, de Gérard Blain à Dino Risi. Les soldats inconnus, les soutiers de l’édition ne le rebutent pas non plus. C’est une bonne fée. Quelque chose comme le Rilke des aspirants critiques et des jeunes auteurs. Il veille sur eux, il les conseille, il les guide, au besoin il les recommande. Avec tact et discrétion. Comme un frère aîné. On ne le voit pas nécessairement, mais il est toujours là, en retrait. C’est un servant, au sens religieux du terme. Il sert les œuvres et les auteurs – en critique accompli. Il n’y a rien à redire sur les critiques, encore moins sur les critiques de premier plan. Ils sont indispensables, ne serait-ce que pour trier le bon grain de l’ivraie. Ce sont les gardiens du goût (et son service d’égout). Sans eux, c’est la démocratie qui réglerait tout, le pire des régimes en art.
Commémoration oblige, il a ressorti son « Mai 68 de la Nouvelle Droite ». Où l’on apprend que lui non plus n’a pas échappé aux rêveries des soixante-huitards, même si elles n’ont pas su le retenir. En jeune provincial conquis, mais encore intimidé, il a assisté aux « événements » sans y assister vraiment, un peu comme Fabrice del Dongo à la bataille de Waterloo, quelque ivresse qu’il en ait tirée. Son idéal d’alors tenait (et on ne sache pas qu’il ait changé sur ce point) en une « abbaye de Thélème, légèrement actualisée par Wilhelm Reich ». Bref, un lupanar ludique aux allures d’université de tous les savoirs. De quoi satisfaire tous les appétits, et les siens vont de l’amour courtois aux nus les plus lascifs ! Des studios de l’ORTF où il travaillait, il a vu le meilleur du mois de mai parisien, un certain vent de liberté, et a rejeté tout le reste quand il devenait de plus en plus évident que les manifestants n’aspiraient pas à changer la société, mais à en prendre la direction. Déjà, le Rotary perçait sous le col Mao. Pas du goût de Marmin.
La poésie l’a sauvé, depuis le premier jour. La vingtaine de poèmes qu’il nous livre ici suffit à le prouver. Il les a rebaptisés « chansons », mais on les lit avec la lenteur que requièrent les textes rares et précieux, cela dit sans flatter leur auteur. À quoi bon le flatter d’ailleurs. Ce qu’il écrit est déchirant, traversé d’une nostalgie aussi poignante qu’une vieille complainte. C’est tout un monde convalescent qui refait surface, sauvé des eaux de l’oubli, fait d’évocations communes, de souvenirs familiers, de blessures secrètes. On pourrait presque dire à la façon d’Alain-Fournier : ce que j’aime chez lui, ce sont mes souvenirs d’enfance. Même s’il a une affection particulière pour son cher Péguy, c’est bien à l’auteur du Grand Meaulnes qu’il fait d’abord penser. Il nous berce comme s’il nous promenait en barque, dans l’alternance des vers et des réminiscences, au rythme de ce roulis léger qu’est l’alexandrin. On sort de là avec une sensation de douceur frissonnante, de mélancolie caressante, sans larmes, mais le cœur gonflé, plein de la piété qui habitait Maeterlinck quand il écrivait Le Trésor des humbles. Ce sont les jours et les heures passés, l’antique quotidien des campagnes, les gestes des grands-mères et des petits-enfants (ceux de Michel sauront quoi lire plus tard, il leur laisse une série de photos magnifiques), qui ressurgissent, d’un sous-bois, d’une maison vide, d’une fin d’après-midi.
Il est rare de lire une prose et une poésie aussi authentiquement françaises. Il y a certes plusieurs France, mais il y en a une qui l’est plus que les autres. Peut-être est-ce une France idéelle, chimérique, pareille à un songe nervalien, entourée d’un brouillard léger, colorée de pastel, aux printemps et aux automnes qui s’étirent sans fin. Le pays du milieu du monde, in media res, aux battements calmes. La « dulce France », celle qui affleure déjà dans le chant de Rolland à Roncevaux et qui a trouvé en Anjou son climat idéal et sa constellation poétique, autour de du Bellay. Peu importe au fond qu’elle s’éteigne à Narbonne avec Trenet, elle restera à jamais angevine. Michel Marmin la fait revivre, de Beaufort-en-Vallée, ville d’Anjou, où il a ses attaches – le temps d’une chanson.